Arbres emblématiques de la Méditerranée et des régions chaudes, l’Oranger (Citrus sinensis) et le Bigaradier (Citrus aurantium), ou Oranger amer, ont traversé les âges et les cultures, porteurs de symboles profonds et de saveurs singulières. Bien qu’ils partagent des origines communes, ces deux arbres se distinguent par leurs caractéristiques et leurs usages. Leur histoire est un voyage à travers le temps, la symbolique et les secrets de ces deux arbres enchanteurs, depuis leurs racines en Asie jusqu’à leurs rôles dans nos vies contemporaines.

Le mot “orange” trouve son origine dans le sanskrit nāranga, qui signifiait initialement “fruit favori des éléphants”. De l’Inde, ce terme a voyagé à travers le persan (nārang), l’arabe (naranj), puis l’espagnol (naranja), avant d’arriver en français où il perd son “n” initial, par phénomène d’élision avec l’article “une narange” devenu “une orange”.
Le Bigaradier, quant à lui, doit son nom au mot italien bigarade, qui désigne un fruit amer et rugueux. Ce terme renvoie directement à la texture de son écorce et à la saveur piquante de son jus, bien différente de celle de l’orange douce. Son nom botanique, Citrus aurantium, vient du latin aurantium, qui signifie “doré”, une référence poétique à l’éclat lumineux de ses fruits. Quant à Citrus sinensis, nom scientifique de l’Oranger doux, il rappelle son origine chinoise (sinensis signifiant “de Chine”), région où il fut cultivé bien avant son introduction en Europe.
Origines de l’Oranger et du Bigaradier
Le Bigaradier est originaire des contreforts de l’Himalaya et fut domestiqué en Chine dès 2200 avant J.-C. Il gagne ensuite le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe par l’intermédiaire des marchands arabes entre le IXe et le Xe siècle. Rapidement adopté dans la péninsule ibérique, il devient un arbre emblématique de l’Andalousie, où il est encore aujourd’hui omniprésent sous le nom d’Oranger de Séville.
L’Oranger doux, quant à lui, est issu d’hybridations naturelles entre la mandarine et le pomelo. Il ne gagne l’Europe qu’au XVe siècle grâce aux explorateurs portugais qui le rapportent de leurs voyages en Chine. Son goût sucré et agréable en fait un fruit précieux, réservé d’abord aux cours royales avant de se diffuser plus largement.
Les botanistes et le développement en Europe
Avec l’introduction des Orangers en Europe, plusieurs botanistes et jardiniers se sont intéressés à leur culture et à leur acclimatation sous les climats tempérés. Au XVIe siècle, l’Italien Pietro Andrea Mattioli les décrit dans ses travaux botaniques, insistant sur leur valeur médicinale et ornementale. Au XVIIe siècle, les orangeries deviennent des éléments incontournables des jardins royaux et aristocratiques. En France, Jean-Baptiste de La Quintinie, jardinier de Louis XIV, développe des techniques de culture sous serre pour protéger les agrumes du froid. L’Orangerie du Château de Versailles, édifiée par Jules Hardouin-Mansart, témoigne de cette passion pour ces arbres exotiques.

En Angleterre, John Evelyn, célèbre botaniste et écrivain du XVIIe siècle, mentionne dans ses écrits l’importance des agrumes en horticulture et les efforts pour les cultiver en serre. Plus tard, au XIXe siècle, Auguste Hardy, jardinier en chef du Jardin des Plantes à Paris, affine les méthodes de culture sous verre, rendant possible la culture d’agrumes même sous des climats plus froids.
Le développement du transport maritime et des jardins botaniques a permis aux agrumes de se répandre largement. Les collections de Kew Gardens en Angleterre et du Jardin Botanique de Montpellier ont largement contribué à la conservation et à l’étude des agrumes en Europe.
Symbolisme de l’Oranger et du Bigaradier
Dans de nombreuses cultures, l’Oranger et le Bigaradier sont chargés de symboles forts. Dans la culture chinoise, l’orange est synonyme de chance et de prospérité. Le mot chéng (橙) pour “orange” est un homophone de chéng (成), qui signifie “succès”. Offrir des oranges durant le Nouvel An chinois est ainsi un geste de bon augure. De l’autre côté de la mer de Chine, au Japon, les décorations de kadomatsu (arrangements végétaux de Nouvel An) intègrent parfois des agrumes pour symboliser le renouveau et la fertilité.
Sur le pourtour méditerranéen, le Bigaradier joue un rôle central dans l’ornement des villes et villages. En Espagne, notamment à Séville, il est omniprésent dans les rues, où il embaume l’air printanier d’un parfum inoubliable. Ce n’est pas seulement un arbre décoratif, mais un véritable emblème olfactif de la ville. On dit que son odeur, mêlée aux senteurs du jasmin, marque la mémoire des voyageurs et des habitants.
L’Oranger et le Bigaradier à travers le Monde

Dans de nombreuses cultures, planter un Oranger ou un Bigaradier près de chez soi est considéré comme un porte-bonheur. En Andalousie, on les trouve dans les patios traditionnels, où ils apportent fraîcheur et sérénité. Dans le sud de la France, on les plante volontiers dans les jardins comme un symbole de prospérité. En Italie, la fleur d’oranger est depuis longtemps associée aux mariages. Les Romains utilisaient déjà ses fleurs dans les rituels nuptiaux, une tradition qui s’est perpétuée au fil des siècles. La Sicile, grande productrice d’oranges, en a fait un élément clé de sa gastronomie et de sa culture. Avez vous déjà goûté la salade sicilienne ?
Dans le monde arabe, la fleur d’oranger est essentielle à la culture et à la cuisine. L’eau de fleur d’oranger, produite à partir de la distillation des fleurs du Bigaradier, est un ingrédient incontournable dans la pâtisserie et les boissons. On l’utilise notamment dans le thé à la menthe marocain, dans les pâtisseries syriennes et libanaises comme les baklavas. Mais encore dans les parfums orientaux aux notes florales et envoûtantes.
Offrir des oranges est également un geste fort dans plusieurs traditions. En Espagne et en Italie, il est coutume d’offrir une orange à un invité pour exprimer l’amitié et la gratitude. Au Moyen-Orient, la fleur d’oranger est parfois ajoutée aux bouquets de mariage pour symboliser un avenir heureux.
Gourmands et utiles

L’Orange douce est consommée fraîche ou en jus, appréciée pour sa saveur sucrée et sa richesse en vitamine C. Son zeste est aussi utilisé pour aromatiser divers plats et desserts.
Le Bigaradier, en revanche, est prisé pour ses fleurs, ses feuilles et son zeste. C’est un des rares agrumes dont la totalité de la plante est transformable. Les fleurs sont distillées pour produire l’huile essentielle de néroli, dont le parfum suave et envoûtant est très apprécié. Ses feuilles fournissent une autre huile essentielle : celle de petitgrain, que l’on retrouve en aromathérapie. Elle possède des propriétés relaxantes. Le zeste de l’Orange amère est employé dans la confection de marmelades et de liqueurs telles que le Grand Marnier et le curaçao.
Un Bigaradier au goût pas si amer
Originaires de climats chauds et subtropicaux, les Bigaradiers s’épanouissent dans des zones où la chaleur et la lumière abondent. Mais ils tolèrent mal les gelées prolongées. Leur besoin d’un sol bien drainé et légèrement acide est essentiel pour éviter l’engorgement racinaire. Un problème courant dans les sols lourds ou argileux.
Le Bigaradier, souvent considéré comme plus rustique, résiste mieux aux conditions de sécheresse et à des sols pauvres grâce à son système racinaire robuste. Il supporte également les températures légèrement plus fraîches. Ce qui explique sa présence dans des régions méditerranéennes où les hivers peuvent être modérément froids. Ses branches épineuses et son feuillage dense servent de protection naturelle contre les herbivores, une adaptation héritée de ses origines sauvages.
Un Oranger pas si doux

L’Oranger doux, en revanche, est moins tolérant aux variations climatiques et demande davantage de soins. Sa culture nécessite un apport régulier d’eau, particulièrement pendant la floraison et la fructification. Sa capacité à produire des fruits sucrés en quantité dépend de la fertilité du sol et de l’apport de nutriments, notamment de l’azote, du potassium et du magnésium. Contrairement au Bigaradier, l’Oranger doux est souvent greffé. Généralement sur des porte-greffes adaptés pour renforcer sa résistance aux maladies et améliorer son développement dans différents types de sols.
Aujourd’hui, les Orangers et les Bigaradiers continuent de susciter l’admiration pour leur parfum, leur symbolisme et leur beauté. Ils rappellent l’importance de la nature et des traditions anciennes dans nos vies modernes. Les jardins et les rues où poussent ces arbres et où leur parfum flotte sont comme des ponts entre passé et présent, entre nature et culture. À travers leurs fruits, leurs fleurs et leurs parfums, ils nous invitent à célébrer l’harmonie entre l’être humain et le reste du vivant.
_______
Sources :
- https://nerolium.fr/le-bigaradier/
- https://www.pomologie.fr/le-bigaradier-un-agrume-importe-en-europe-au-moyen-age/
- https://www.luminessens.org/post/2017/03/14/loranger
- https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/bigaradier-citrus-aurantium-culture%2C2640.html
- https://www.france-mineraux.fr/phytotherapie/guide-plantes-medicinales/bigaradier/
- https://www.floranjou.fr/blog/l-oranger-bigaradier-tour-d-horizon-de-cet-arbre-oriental–n54
- https://www.lubera.fr/journal/bigaradier-p1793
________

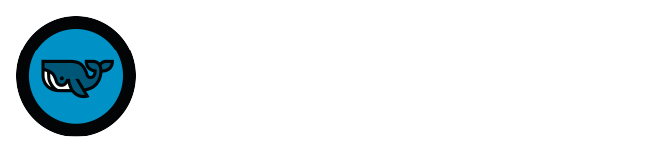


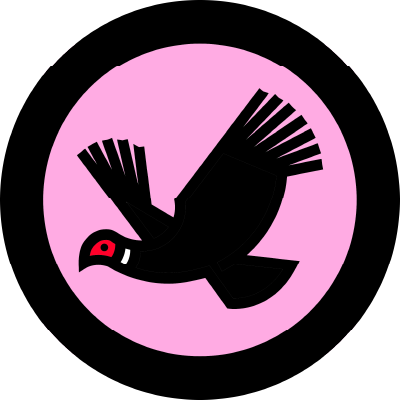
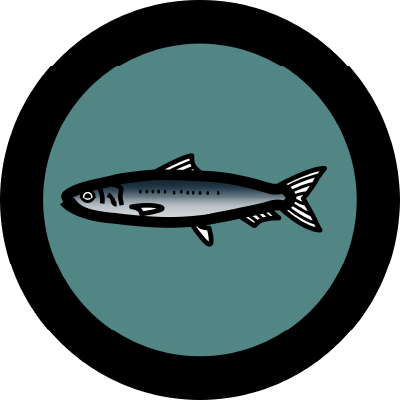

 Baleine sous Gravillon
Baleine sous Gravillon Combats
Combats Petit Poisson deviendra Podcast
Petit Poisson deviendra Podcast Nomen
Nomen France Culture | Mécaniques du Vivant
France Culture | Mécaniques du Vivant