Qui fait peur aux vacanciers et montre ses antennes dès que le melon arrive sur la table de pique-nique ? Bingo, la Guêpe. Ce nom vernaculaire désigne en fait de nombreux insectes de l’ordre des Hyménoptères, généralement noir et jaune. Le plus souvent lorsque l’on parle de Guêpes on parle soit de la Guêpe commune Vespula vulgaris soit de la Guêpe germanique Vespula germanica. Mais ne s’intéresser qu’à ces deux représentantes serait réducteur puisqu’elles sont des milliers d’espèces à bourdonner à travers le monde.
Le mot “Guêpe” est issu de l’ancien français “guespe” que l’on retrouve dans le “dictionnaire du Moyen Français” de 1330. Avant cela, le mot est attesté sous la forme “wespe” vers 1180. Sa forme italienne “vespa” a donné son nom à un célèbre deux-roues, symbole de la dolce vita.
Contrairement à sa cousine l’Abeille, la Guêpe a rarement bonne presse auprès du public qui craint sa piqûre. Les expressions “nid de Guêpes” ou “tomber dans un Guêpier” sont plutôt hostiles. La caractéristique qu’on met en avant positivement ? Sa “taille de Guêpe” que l’on a longtemps cherché à reproduire aux moyens de corsets et autres guêpières.

© Alan Manson
Les Guêpes se nourrissent principalement de nectar, de fruits mûrs et parfois de petits insectes. En se déplaçant de fleur en fleur pour chercher du nectar, elles participent à la pollinisation.
Quelques-unes sont même spécialisées et indispensables à la pollinisation de certaines espèces. Ainsi les Agaonidés, surnommées Guêpes du figuier, comme Blastophaga psenes par exemple, vivent en symbiose avec l’arbre. La femelle qui mesure à peine 1 à 2 mm pond ses œufs à l’intérieur de la figue qui est en réalité une inflorescence fermée. En circulant à l’intérieur pour déposer ses œufs, elle transporte le pollen d’un figuier à un autre. Elle assure ainsi la pollinisation. Cette relation, vieille de 87 millions d’années, est indispensable à la reproduction de nombreuses espèces de figuiers. Ce type d’interactions qui bénéficie à la plante comme à l’insecte se nomme mutualisme. Sans ces Guêpes, pas de figues.
Une Guêpe peut en cacher une autre, avec ou sans piqûre
Le terme Guêpe est extrêmement peu précis mais dans le langage courant il désigne en priorité les insectes du genre Vespula.

Pour gagner en clarté, on peut diviser ce groupe en deux sous-groupes principaux : les Guêpes sociales et les Guêpes solitaires qui présentent une grande diversité de formes, de tailles et de couleurs. Concrètement, dans l’arbre phylogénétique c’est le sous-ordre des Apocrites qui nous intéresse. Il regroupe tous les insectes avec une “taille de Guêpe” entre le thorax et l’abdomen, y compris toutes les fourmis et abeilles. Cela fait des Apocrites le plus grand des sous-ordres d’insectes, les liens de parentés internes doivent encore être consolidés par d’autres études.
Parmi les insectes volants dont on oublie parfois qu’ils sont des Guêpes : les Frelons. Ils appartiennent à la famille des Vespidés, qui comprend plus de 5 000 espèces de Guêpes. Qu’ils soient européens ou à pattes jaunes, ils sont les mal-aimés et les plus craints de ces insectes. Chaque été, en raison de leur grande taille et des prédations qu’ils font dans les rûchers, ils défraient la chronique. Et oui, pour nourrir leurs larves, les Frelons choisissent la facilité. Quoi de plus simple que de venir se servir dans le garde-manger que représente une ruche abritant des milliers d’abeilles.

Ces insectes eusociaux s’organisent en castes avec une reine unique, des ouvrières stériles et des mâles saisonniers. Leur cycle de vie, comme celui des autres Guêpes, commence lorsque la femelle pond ses œufs dans un nid préparé ou parfois dans un hôte. De ces œufs éclosent des larves. Elles se nourrissent généralement de proies capturées par l’adulte ou de l’hôte lui-même, selon l’espèce. Après plusieurs stades de croissance, la larve se transforme en nymphe dans un cocon ou un abri. Puis, émerge un adulte prêt à perpétuer l’espèce.
Nid de Guêpe

Les Guêpes sociales construisent des nids afin de protéger et élever leurs larves. Chaque alvéole abrite un œuf ou une larve. Ils sont à la fois une nurserie et un abri offrant une défense contre les prédateurs et les intempéries. Elles les construisent en mâchant des fibres de bois qu’elles mélangent à leur salive pour former une pâte papyracée. Elles construisent des alvéoles hexagonales, une forme qui offre un maximum d’espace avec un minimum de matériaux et qui assure solidité et stabilité. Certaines espèces comme les Guêpes communes construisent autour de ces alvéoles une enveloppe protectrice. Les nids sont souvent suspendus à une branche, un toit ou nichée dans un abri souterrain.
Les Guêpes polistes, le plus grand genre de Guêpes sociales avec plus de 300 espèces et sous-espèces, construisent un nid composé d’un seul rayon d’alvéoles hexagonales orientées vers le bas. Ce nid, fixé généralement à un support (branche, tige, poutre, rebord de toit) par une fine tige centrale appelée “pédicelle”, n’est pas protégé d’une enveloppe protectrice.
Parmi ces nids à l’architecture remarquable, celui de Polistella brunetus. Il a permis aux chercheurs Bernd Schöllhorn et Serge Berthier de faire une découverte… “brillante”.
En effet, en 2021, au Nord du Vietnam, munis d’une lampe UV, ils ont pour la première fois découvert des nids de Guêpes fluorescents.
Les nids en eux-mêmes ne sont pas fluorescents. Ce sont les protéines de soie sécrétées par les larves pour operculer les alvéoles qui émettent la lueur fluorescente. Les capacités de fluorescence de ces opercules sont parmi les plus élevées observées pour un tissu animal terrestre.
Si j’avais un marteau… version guêpe

Maçonnes, tapissières ou potières, les Guêpes solitaires rivalisent de technique et d’ingéniosité pour bâtir des refuges adaptés à leur progéniture. À l’inverse des Guêpes sociales, elles travaillent seules. Elles façonnent avec précision des nids qui sont à la fois berceaux et garde-manger. Chaque espèce développe sa propre technique : poteries suspendues aux branches, galeries creusées dans le sable, ou cavités garnies d’herbes.
Il existe de nombreuses espèces de Guêpe potière ou maçonnes. Parmi elles, Eumenes coronatus, répandue principalement en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient construit un petit nid en forme d’amphore avec de la boue qu’elle façonne minutieusement.
Certaines de ces Guêpes maçonnes sont au cœur d’un mythe bien ancré au Sénégal. Ainsi, punie par Dieu pour avoir désobéi et observé la création, la Guêpe ne peut enfanter. Elle doit donc créer ses petits à partir de larves d’autres insectes. Des observations quotidiennes renforcent ce récit transmis dès l’enfance. En effet, comment avec sa taille fine, la Guêpe pourrait-elle donner la vie ? Et il est aisé d’observer une femelle transporter des chenilles (qu’elle aura chassées pour nourrir les larves) jusqu’à sa construction avant d’en voir sortir plus tard une Guêpe complètement formée… Preuve que la transmutation des espèces est bien possible ! Cet exemple nous rappelle que nous observons notre environnement par le prisme de notre culture et que lorsque ces observations confortent nos croyances nous nous y accrochons.
Dard d’art : l’arme secrète des Guêpes

Le dard, du francique daroth, “arme de jet” est un organe d’attaque ou de défense pour les Guêpes : des études anatomiques et phylogénétiques, considèrent que le dard est une modification de l’ovipositeur. Chez les hyménoptères aculéates comme les Guêpes, Abeilles et certaines Fourmis, ce dard est exclusivement présent chez la femelle. Chez la Guêpe, le dard est lisse, sans barbes, ce qui lui permet de le retirer facilement et de piquer plusieurs fois, contrairement aux Abeilles domestiques dont le dard s’arrache de leur abdomen, ce qui leur est fatal après la piqûre.
Le venin des Guêpes est un mélange complexe d’enzymes, de protéines et d’amines biogènes, différent de celui des Abeilles. Bien que plus toxique à dose égale, les Guêpes injectent généralement des quantités bien plus faibles que les Abeilles. On estime cette dose de l’ordre de 50 à 100 microgrammes pour l’Abeille et de 2 à 10 microgrammes par piqûre pour la Guêpe .
D’un point de vue évolutif, il semble que les ancêtres des Hyménoptères aculéates utilisaient déjà l’ovipositeur pour injecter du venin, afin de paralyser leur proie tout en la maintenant vivante pour nourrir leurs larves. Ce comportement s’observe notamment chez les Guêpes parasitoïdes qui comptent entre 150 000 et 600 000 espèces.

Certaines comme les Guêpes parasites Cotesia utilisent un bracovirus intégré à leur génome depuis 100 millions d’années pour parasiter des chenilles. Lorsqu’elles pondent, elles injectent ce virus avec leurs œufs. Elles neutralisent les défenses immunitaires de l’hôte ce qui permet aux larves de se développer. Ce scénario digne d’un film de zombie met aussi en lumière un autre phénomène : celui de la “domestication” d’un virus. Chez les Cotesia, le bracovirus n’est plus reconnu comme étranger. Il s‘agit là d’un rare exemple de domestication de virus complexes qui pourrait probablement exister plus largement dans l’évolution.
Cette capacité exceptionnelle font des Cotesia des redoutables armes biologiques contre certains ravageurs . Ainsi, depuis les années 80, le Brésil produit massivement ces Guêpes pour protéger les cultures de canne à sucre des Chenilles foreuses de tiges.
La Guêpe et ses cousins, souvent redoutées pour leur piqûre, jouent pourtant un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. Leur diversité de comportements et d’interactions révèle une adaptation remarquable aux défis de leur environnement. Aujourd’hui, l’étude de leurs relations avec les virus, les plantes ou leurs proies ouvre de nouvelles pistes pour l’agriculture durable et la lutte biologique.
________
Pour aller plus loin:
- Sur le mutualisme : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534703000624
- Sur la fluorescence : https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rsif.2021.0418
- Sur les capacités des Cotésias : https://www.nature.com/articles/s42003-020-01623-8
________
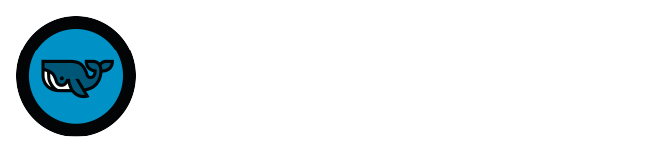


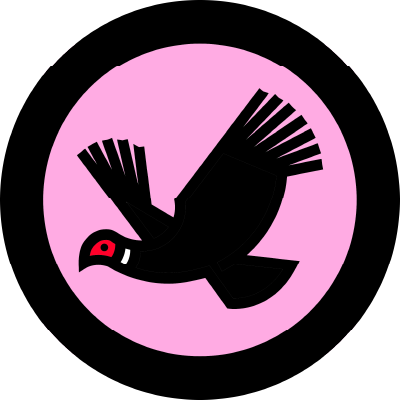
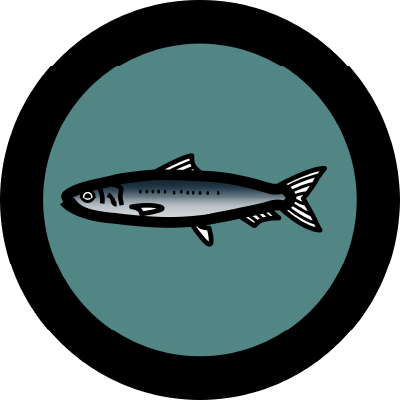

 Baleine sous Gravillon
Baleine sous Gravillon Combats
Combats Petit Poisson deviendra Podcast
Petit Poisson deviendra Podcast Nomen
Nomen France Culture | Mécaniques du Vivant
France Culture | Mécaniques du Vivant