Septembre, un mois de traditions, de rituels, de rendez-vous. La rentrée des classes, les vendanges, le début de la cueillette des champignons… et le retour d’un moment magique pour les amoureux du Vivant : le brame du Cerf. Le brame désigne à la fois la période de rut et le cri du Cerf qui résonne dans de nombreuses forêts françaises dès mi-septembre. A l’arrivée de l’automne, lorsque les jours raccourcissent, les Cerfs entrent dans leur période de reproduction et le font savoir !
L’occasion de jeter un œil et une oreille sur un comportement qui ne passe pas inaperçu.

“Cerf” est un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces de cervidés à travers le monde. En France hexagonale, lorsqu’on parle de Cerf, c’est au Cerf élaphe que l’on fait référence. Le Cerf élaphe est aussi appelé Cerf noble, Cerf rouge ou encore Cerf d’Europe. Le Cerf élaphe est un grand ruminant présent dans les forêts d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale. Son nom scientifique est un pléonasme car le mot grec “elaphus” signifie déjà “Cerf”.

Cet animal peut atteindre 1,50 m au garrot et jusqu’à 300 kg selon les sous-espèces. Il est certainement le plus connu de sa famille. Après l’Ours brun des Pyrénées, le Cerf élaphe, et ses 150 kg de moyenne, est le plus gros mammifère terrestre présent en France hexagonale. Ils sont facilement reconnaissables grâce aux bois qu’arborent les mâles.
Avant l’âge de six mois, impossible de différencier les deux sexes à l’œil. La tête plus large et les pivots qui deviendront des bois, observables dès 8/9 mois, permettent de reconnaître les mâles. Ces bois ne seront vraiment visibles qu’à partir d’un an, moment où le faon mâle prend l’appellation de daguet. Les mâles des 51 espèces de la famille des Cervidés ont la particularité de porter des bois à l’exception de Hydropotes inermis, le Cerf vampire en Asie, qui possède des canines très développées ou encore Pudu puda, le Pudu du Chili, le plus petit cervidé du monde dont les bois sont à l’état de simple vestiges.
Promenons-nous dans les bois
Les bois, excroissances osseuses qui font la majesté des Cerfs, tombent chaque hiver et repoussent au printemps. Pendant la phase de croissance, ils sont recouverts d’un tissu vascularisé appelé velours qui apporte les nutriments et les cellules nécessaires à l’ossification. Avant la période de rut, ils se calcifient puis perdent leur velours. Enfin, après la période de reproduction, la base s’atrophie, puis ils tombent. Ce cycle recommence chaque année. Les bois sont de véritables baromètres hormonaux. Sans testostérone, leur croissance est incomplète. Leur taille impressionnante devient un signal visuel de vigueur sexuelle. Ils permettent principalement d’exprimer un rang dans la hiérarchie, d’assurer la dissipation des phéromones et d’engager des combats. Contrairement aux cornes, portées par les bovidés (bovins, caprins, ovins et antilopes…), les antilocapridés (pronghorn) et les rhinocérotidés, les bois sont des organes osseux vascularisés, portés principalement par les mâles. Exception faite des Rennes, où mâles et femelles en possèdent .

Le vocabulaire associé aux bois de Cerf est à la fois riche et précis. Les merrains désignent les branches principales qui supportent la structure de la ramure, les andouillers ou cors en sont les ramifications secondaires, et la ramure correspond à l’ensemble de la formation osseuse. Les termes plus spécifiques, comme santons, perches ou ganaches, permettent de localiser des segments particuliers, surtout dans le langage cynégétique.
Les bois des Cerfs peuvent croître jusqu’à 2,5 cm par jour pendant la phase de croissance. Ce qui en fait l’un des tissus osseux à croissance la plus rapide chez les mammifères !
En 2023, un Cerf jurassien a fait la une des journaux locaux. Avec ses 24 cors et un âge estimé de 18-20 ans, il était devenu un symbole de la forêt de Chaux, près de Dole.
Celui qui en parle le plus…
Le brame, qui désigne la période de rut des Cerfs, désigne aussi leurs vocalisations. Le Cerf élaphe peut émettre un aboiement “de contact” ou un brame constitué de cris répétés terminés par un cri de victoire à des fréquences autours de 112 Hz. Ce timbre profond fait office de carte d’identité : il reflète la taille et la condition physique du mâle. Sous-espèce plus petite du Cerf élaphe continental et réintroduite en Corse dans les années 1960 depuis la Sardaigne, le Cerf corse se distingue par un brame très grave à 36 Hz, répété en cris de victoire.
Les séquences de brames servent à intimider les rivaux afin d’éviter le recours aux combats physiques. Mais il sert aussi et surtout à se signaler aux femelles en chaleur afin d’assurer la reproduction de l’espèce. Dès lors, il serait plus précis de parler non pas seulement du “brame du Cerf”, mais de la saison des amours du Cerf et de la Biche.

Derrière le spectacle sonore du brame, le rôle des biches est déterminant car c’est leur cycle court et précis qui conditionne tout l’événement. La période des chaleurs (œstrus) est très courte, 24 à 48h ce qui laisse peu de temps au mâle pour se démarquer et être choisi par une ou plusieurs femelles.
En effet, malgré les combats et les vocalises des Cerfs, ce sont les Biches qui choisissent le mâle avec lequel elles vont s’accoupler. Elles exercent un choix actif et évaluent la vigueur des brames, la posture, ou la capacité du mâle à défendre un groupe. Leur rôle est donc décisif dans la transmission des gènes.
Ce processus de sélection sexuelle privilégie les individus en meilleure condition, garantissant ainsi une descendance plus robuste. Cependant, certains jeunes ou petits mâles profitent de l’agitation : tandis que les grands cerfs s’affrontent ou paradent, ces opportunistes parviennent à s’accoupler discrètement avec quelques femelles.
Le Cerf, un roi sans royaume ?
Il n’est pas rare d’entendre parler de “roi” ou “seigneur” de la forêt lorsqu’on parle du Cerf. En effet, son image dans la culture populaire, la littérature ou le cinéma est souvent associée à la majesté et la puissance. Il est vu comme un gardien de la forêt, symbole de fertilité, de mort et de renaissance en Europe ou de pureté au Japon. De la Préhistoire, avec ses représentations sur les parois des grottes, au Cerf blanc chassé par Saint Hubert, le Cerf est au cœur des contes et croyances à travers tous les âges et tous les continents.

Cependant, cette représentation idéalisée masque une réalité écologique complexe. Bien que le Cerf soit aujourd’hui associé aux forêts, il était à l’origine un habitant de milieu semi-ouvert à ouvert. La pression humaine, notamment la chasse et l’urbanisation, a contraint cette espèce à se réfugier dans les massifs forestiers. Ainsi ses comportements et son habitat naturel sont modifiés. En Écosse, il vit encore en forte densité dans de vastes landes ouvertes dépourvues de forêt.
L’image du Cerf gardien d’un royaume élude aussi une réalité biologique. Lors du brame, la compétition a un coût physiologique considérable. Certains mâles peuvent perdre jusqu’à 20 % de leur poids en quelques semaines. Ils finissent épuisés par les déplacements, les combats et l’absence quasi totale d’alimentation. Pour tenter de féconder un maximum de femelles, ils engagent littéralement leur capital santé.
En danger critique d’extinction en Grèce, le Cerf a failli disparaître de certaines régions en France. Toutefois depuis l’instauration des plans de chasse dans les années 1960 et la disparition des grands prédateurs, comme le Loup gris, sa population est en augmentation continue. Aujourd’hui, on estime à 180 000 le nombre de Cerfs présents dans l’hexagone. Cette croissance couplée au rétrécissement et à l’exploitation humaine de son territoire mène inévitablement à des déséquilibres ou des tensions. Les questions de régulation ou de gestion cynégétique reviennent régulièrement sur le devant de la scène.

Le brame du Cerf est un moment spectaculaire. Rivalités et parades fascinent et attirent les observateurs, qu’ils soient naturalistes ou simples badauds. Mais ce temps court et décisif pour la reproduction ne supporte ni intrusion ni dérangement. Les affûts photo ou d’observation doivent donc se préparer en amont. Il est important de rester en lisière des places de brame, sans intervention sur le milieu ni déplacements répétés. Silence, immobilité, absence de lumières ou d’appels artificiels sont indispensables pour ne pas interrompre les interactions entre mâles et femelles.
Admirer le Cerf, est un moment privilégié et implique de rester un témoin discret. Il y a quelques jours, le réalisateur Nicolas Sallé arrivait au bout d’un pari fou. Ainsi, grâce à un dispositif de sept caméras, en pleine forêt, filmant 24 heures sur 24 pendant 3 semaines (504 heures de direct du 8 au 29 septembre 2025), il a permis à des milliers de spectateurs de vivre cette expérience… et ce, au plus près, tout en limitant les nuisances humaines. À l’heure des réseaux sociaux où l’image et l’instantanéité donnent l’illusion d’un accès total à tout, tout le temps, ce projet de “slow tv “ ne permet-il pas de questionner notre juste place face au Vivant et notre besoin d’émerveillement ?
_______
Sources :
- Le documentaire de France TV : https://www.france.tv/documentaires/le-brame-du-cerf/7598282-le-brame-du-cerf-avec-nicolas-salle.html
- https://www.researchgate.netpublication/255623059_Les_bois_de_Cerf_Revue_de_litterature_scientifique
- Davis Edward Byrd,Brakora Katherine A. andLee Andrew H. 2011Evolution of ruminant headgear: a reviewProc. R. Soc. B.2782857–2865 http://doi.org/10.1098/rspb.2011.0938
- Laura Bonnefond, Martin Mayer, Rasmus Mohr Mortensen. Lars Haugaard, Peter Sunde, Red deer in confined nature areas have smaller ranges and move less than red deer in unconfined areas, Science of The Total Environment, Volume 969,2025,179008,ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.179008.
- MORELLET, N., GUIBERT, B., KLEIN, F., & DEMOLIS, C. (1997). Utilisation de l’habitat forestier par le Cerf (cervus elaphus) dans le massif d’Is-sur-Tille (Côte-d’Or). Sciences Eaux & Territoires, (9 Ingénieries-EAT), 25–34.
_______
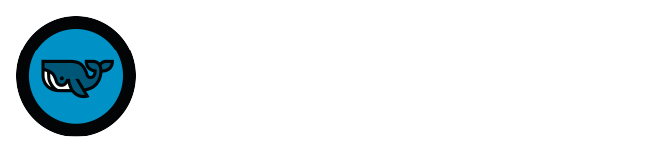


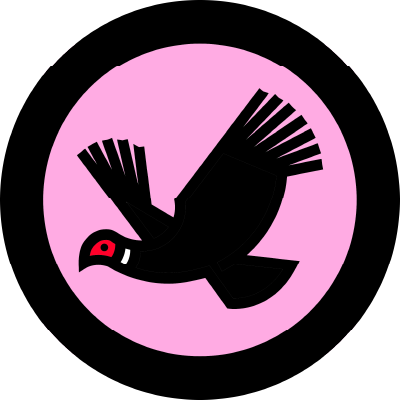
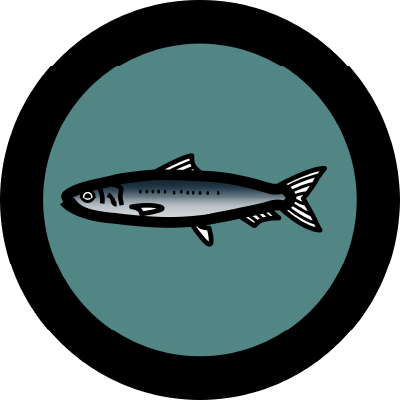

 Baleine sous Gravillon
Baleine sous Gravillon Combats
Combats Petit Poisson deviendra Podcast
Petit Poisson deviendra Podcast Nomen
Nomen France Culture | Mécaniques du Vivant
France Culture | Mécaniques du Vivant